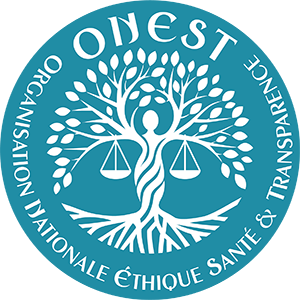L’Alliance pour l’Instruction En Famille (AIEF) au sein de l’ONEST
L’AIEF constituée au sein de l’association ONEST a pour objectif principal d’obtenir l’abrogation du régime d’autorisation préalable de l’instruction en famille en vue de permettre aux familles françaises de recouvrer la liberté d’instruire leurs enfants.
Pourquoi ?
Parce que le volet éducatif de la loi du 24 août 2021 est illégitime. En effet, ce régime d’exception qu’est l’autorisation préalable exceptionnelle, dénie par principe, aux familles une prérogative fondamentale : la possibilité de donner elles-mêmes l’instruction à leurs enfants.
Il suffit de revenir aux principes de bon sens, tout droit issus du droit naturel qui font des parents les premiers éducateurs des enfants : ce sont eux en effet qui leur ont donné la vie. Or, l’instruction est une composante essentielle de l’éducation.
Certes, la famille est une société imparfaite et tous les parents n’ont pas la capacité de donner cette instruction. D’où l’existence de l’école, institution parfaitement légitime et même, essentielle.
Mais si des parents sont en capacité de donner cette instruction et choisissent de le faire, ils ne peuvent en être empêchés ; ils ne font qu’exercer une des prérogatives fondamentales de ce rôle d’éducateurs.
L’État (ou beaucoup mieux, un autre corps intermédiaire) ne peut que se borner à contrôler l’effectivité de cette instruction.
Là est la raison fondamentale de notre combat.
Cependant, pire qu’illégitime, cette loi est le marqueur de la dérive totalitaire du régime. Il ne s’agit pas d’un effet de style, et ce qualificatif n’est pas abusif ; il est exact, ni plus ni moins.
Que signifie le mot « totalitaire » ?
Un régime peut être qualifié de totalitaire quand l’État entend réglementer et surveiller la totalité de la vie politique, sociale, religieuse, familiale et qu’il nie l’intériorité humaine en investissant toutes les sphères de l’intimité de la personne humaine. Dans une telle société ne subsiste qu’une multitude d’individus seuls face à l’État.
À l’inverse, dans une société ordonnée l’État se cantonne aux missions que lui seul est à même de mener à bien : sécurité du territoire, grandes orientations et mesures économiques, principes judiciaires fondamentaux, etc.
Dès qu’une mission peut être assumée par un corps ou une entité plus petite, l’État a l’obligation de lui laisser assumer cette tâche, au nom du principe de subsidiarité.
Au vingtième siècle certains régimes ont pu être qualifiés de « totalitaires » dans leur volonté de contrôler tous les aspects de la vie sociale. Qui plus est, ce contrôle s’accompagnait d’une exigence plus positive. Il fallait aussi donner des preuves d’adhésion à l’idéologie promue par l’État. C’est ainsi que le communisme de type soviétique (régimes issus du marxisme-léninisme et de ses variantes) ou le nazisme ont été qualifiés de régimes totalitaires. La Révolution française (surtout la phase jacobine-montagnarde de 1792-1794) est considérée comme le premier régime historique à avoir expérimenté, à grande échelle et de façon consciente, une politisation totale de l’existence en vue de « régénérer » l’homme et de créer un Homme nouveau. C’est ce qu’on appelle parfois le premier totalitarisme moderne ou le prototype du totalitarisme.
Quand on emploie le mot totalitaire, on pense naturellement à un régime autoritaire ; inversement on est taxé d’exagération, lorsqu’on prétend, comme ici, qu’une loi totalitaire peut être votée dans un régime dit démocratique.
En fait, dès qu’un État sort de façon non nécessaire de ses missions traditionnelles, il connaît une dérive totalitaire. Celle-ci est plus ou moins aboutie et sensible. Qu’importe, à partir du moment où elle existe, la gravité de cette déviation ne saurait être minorée.
La négation du droit à choisir l’instruction en famille en est un cas typique ; sans nécessité, l’État prétend se substituer aux familles. De façon plus positive, le but est ensuite d’endoctriner les enfants au nom du fameux « socle commun » et des idéologies à la mode (genre, inclusion…).
Mesure-t-on à terme la gravité d’une telle dérive ? On pourrait de prime abord ne voir dans ce combat qu’une cause isolée et accessoire qu’il serait plus sage de sacrifier à la défense d’enjeux plus importants, y compris dans le domaine éducatif. Il est vrai qu’en France, l’instruction en famille n’a jamais concerné qu’une petite minorité d’enfants.
Qui ne voit cependant pas que derrière cette loi c’est la liberté de l’instruction toute entière qui est menacée ? La suppression par principe de l’instruction en famille constitue en elle-même la négation de la liberté d’instruire un enfant comme ses parents l’entendent, une première en France. À partir du moment où cette brèche existe, ne fût-ce que pour une petite minorité d’enfants, on ne voit pas ce qui peut arrêter la machine étatique dans la logique qu’il aura réussi à imposer.
Derrière l’instruction en famille, l’enseignement hors contrat, lui aussi attaqué par la loi du 24 août 2021, est directement menacé. En effet, il y a fort à parier que ce mode d’enseignement, qui ne concerne que 61 500 enfants en 2025 contre 12 millions scolarisés dans l’enseignement public ou sous contrat, ne tiendra pas longtemps non plus. On peut compter sur le génie machiavélique du Président de la République pour interdire l’enseignement vraiment libre.
Alors que l’enseignement sous contrat a depuis longtemps été mis au pas, le niveau des petits Français continuera à s’effondrer, victime tout à la fois du formatage idéologique, de la perversion morale de certains programmes et de la nullité de méthodes d’apprentissage prétendument adaptées. Une fois de plus, comme dans tant d’autres domaines, la tactique du salami aura triomphé.
L’éducation, puisque c’est elle que l’État entend prendre en main, conditionne ni plus ni moins la société à venir. Que sera cette dernière, une fois ces derniers bastions de résistance tombés ? Allons-nous laisser assassiner intellectuellement, moralement et même spirituellement nos enfants, et derrière eux, la France de demain ?
Il est au moins un point sur lequel nous sommes d’accord avec le Président, c’est que ce combat est « la mère de toutes les batailles ».
Comment ?
Faute d’être condamné, ce combat doit respecter des principes fondamentaux.
Face à la tactique du salami, il doit être collectif. L’instruction en famille est avant tout un choix fait individuellement. D’où un risque d’isolement quand il s’agit de la défendre. C’est pourquoi, il est capital que les familles se rapprochent de structures adaptées, sur le plan juridique, financier, social ou même simplement psychologique. Cela, quel que soit le mode de combat choisi, diffère d’une famille à l’autre. C’est ce à quoi s’emploiera « Alliance pour l’Instruction En Famille », ce mot d’alliance n’a pas été choisi au hasard.
Par ailleurs, ce combat prend place au sein d’une lutte plus globale ; il est interdépendant d’autres batailles, dans le domaine éducatif notamment. Aussi le combat d’AIEF n’est pas exclusif. En s’intéressant à ces autres batailles il permettra des échanges constructifs et suscitera l’adhésion de personnes moins directement concernées.
Au demeurant, l’Alliance pour l’IEF a bien conscience de la disproportion qui existe entre elle et la machine étatique. Des moyens très réels existent pour lutter efficacement, mais tant que les gouvernants actuels restent en place, notre association ne peut pas être la plus forte. D’où un principe de prudence. Les appareils judiciaires, politiques, médiatiques, voire internationaux sont bien plus souvent alliés contre nous que l’inverse. Certes, il faut savoir jouer ponctuellement de leurs contradictions, lacunes et même divisions, mais avec discernement en étant sûr du terrain sur lequel on s’avance. D’où la nécessité d’individualiser chaque bataille, tout en avançant ensemble dans la même direction. Ainsi, là où certaines formes de résistance paraissent indiquées pour certains, différentes méthodes seront à privilégier pour les autres.
Par ailleurs, vu l’enjeu et les circonstances, ce combat doit nécessairement être radical. En effet, il s’agit ni plus ni moins de faire face aux intentions subversives de nos gouvernants et à un projet totalitaire déjà bien avancé. Il ne s’agit pas de demander un simple aménagement de la loi, mais sa totale abrogation.
Enfin, ce combat doit être moral. Entendons par là que les principes qu’il défend, doivent eux-mêmes être sains. Certains parents défendent l’instruction en famille au nom du choix qu’auraient fait leurs enfants. Mais qui ne voit que ce choix (à supposer qu’un enfant soit capable d’en mesurer les paramètres…), dénie, ipso facto, aux parents leur autorité, qui découle du droit naturel le plus élémentaire. Du même coup, un tel principe risque d’annuler l’efficacité de la lutte; un juge aura toute latitude pour souligner l’emprise, aussi naturelle soit-elle, des parents sur l’enfant si ce dernier a choisi d’être instruit par eux. Sur ce point, il est bien clair que l’IEF est d’abord un choix parental.
Sur un plan pratique, l’Alliance pour l’Instruction en Famille distingue plusieurs manières de soutenir directement ou indirectement l’IEF. Chacune est détaillée dans le volet ci-après qui lui est consacré. Elles ne sont nullement exclusives les unes des autres.
La voie légale constitue une alternative concrète aux familles qui ne veulent ou ne peuvent se lancer dans une telle bataille. Il s’agit cette fois d’utiliser les possibilités laissées par la loi, afin d’obtenir de l’académie, le droit d’instruire ses enfants. Les termes législatifs sont suffisamment flous pour laisser une marge d’interprétation assez large à la jurisprudence. Une telle manière de combattre peut aussi permettre d’emporter la bataille. Certaines lois ont ainsi fini par tomber dans l’oubli avant d’être abrogées, vidées de toute signification concrète. Une telle perspective s’inscrit cependant dans le long terme.
Sur le plan politique, notre action peut aussi revêtir une certaine efficacité. Le but est de faire pression sur les parlementaires pour les pousser à obtenir l’abrogation de la loi. Qu’il s’agisse de lettres de familles protestant auprès de leurs députés, de pétitions ou même d’entrisme dans certains partis, les moyens ne manquent pas.
Le Conseil Constitutionnel a déjà été saisi plusieurs fois de cette loi, mais ne l’a pas encore étudiée sous tous ses aspects, contestables au regard des droits de l’homme. Une telle action peut être l’œuvre des politiques, mais aussi des juges, grâce aux Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC).
Enfin, en violant l’article 26.3 de la déclaration des droits de l’homme de 1946, adoptée par l’ONU, l’État Français n’a pas respecté le Droit international. L’ONU s’en est d’ailleurs émue dans une communication en date du 16 octobre 2023 et dans un rapport définitif du 30 octobre 2023. Plusieurs actions ont aussi été portées devant la même instance avec succès. À nous également, de savoir étendre notre action dans ce domaine.
En adhérant à l’association ONEST, vous pouvez demander à devenir membre actif (dans la mesure de vos possibilités) de l’AIEF, branche dédiée de l’association.
Afin de faciliter les actions de l’AIEF, il est à noter que l’ONEST développe actuellement les Comités d’éthique ONEST locaux et les Havres ONEST grâce à l’ensemble de ses adhérents.
Une coordination de l’ensemble des branches organisationnelles de l’association pourra être mise en place afin de parvenir aux meilleurs résultats.
Nous vous remercions vivement de votre confiance et de votre courage dans ce combat, nous sommes ravis de vous compter parmi les membres de l’AIEF-ONEST.
In memoriam Aurélianae.